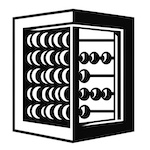Résumés des communicationsConférencier.ères invité.es (ordre alphabétique) - voir en bas de page pour la partie Jeunes chercheuses et jeunes chercheurs Marianna Bosch Transparences mathématiques et phénomènes didactiques à l'âge de l'IA Nous partirons d’une étude mathématique sur la ségrégation scolaire implémentée en formation des enseignants du primaire. L’activité, qui prend la forme d’un parcours d’étude et de recherche, permettra d’illustrer des phénomènes didactiques liés à des aspects de l’activité mathématique qui demeurent transparents aussi bien pour les institutions scolaires que pour les institutions savantes qui interviennent dans les processus d’enseignement. L’analyse nous mènera à considérer les conditions et les contraintes qui affectent les processus d’étude situés à la transition entre le paradigme de la visite des œuvres et celui, plus actuel, du questionnement du monde. Cédric Flückiger Didactique des Mathématiques, didactique de l'informatique : conditions d'un dialogue La didactique des mathématiques et la didactique de l'informatique, malgré une origine commune, présentent malgré tout des différences importantes. Les discuter permet sans doute aux deux disciplines de mieux appréhender leurs propres implicites. Ainsi, seront discutées ici les questions des contenus disciplinaires abordés à l'école, de leurs modes de construction, de leurs finalités sociales, des relations à leur discipline de référence ou encore de la demande sociale adressée à la didactique. Alexandre Guilbaud Vision artificielle et recherche de similarités iconographiques dans les corpus scientifiques illustrés du Moyen-Âge et de la période moderne Réunissant des chercheurs et chercheuses en histoire des sciences et en vision artificielle, le projet VHS vise à concevoir des outils d’analyse numérique permettant de faciliter l’étude des modalités de circulation, d’évolution et de transformation des images dans des corpus historiques du Moyen-Âge et de la période moderne. Fondés sur la détection de similarités iconographiques, via des méthodes d’apprentissage non ou faiblement supervisées, les outils mis au point doivent notamment permettre d’aider à la recherche de processus de copies et d’emprunts dans des corpus illustrés d’envergure. Nous présenterons la méthodologie adoptée dans ce cadre, les outils et interfaces développés à ce stade, ainsi que les premiers résultats obtenus sur les corpus mathématiques choisis pour tester et entrainer les instruments d’analyse du projet. David Rabouin Éditer numériquement des manuscrits anciens Les outils numériques offrent des perspectives très encourageantes pour l’édition des manuscrits mathématiques anciens, mais posent également des problèmes spécifiques, qui sont encore loin d’être réglés. A partir de mon expérience sur l’édition des manuscrits de Leibniz et des collaborations avec des projets semblables, je présenterai quatre directions actuelles de recherche : la transcription à l’aide de l’HTR (Handwritten Text Recognition) et sa possible extension à la reconnaissance des équations ; l’édition des tables et diagrammes ; l’édition des symboles mathématiques anciens ; l’édition génétique des manuscrits. Communications (ordre alphabétique) Alain Bernard La construction de ressources vidéographiques pour la formation : terrain, reflet et source de recherches pédagogiques et historiques La contribution s’appuie sur un projet pédagogique développé dans le cadre de l’INSPE, de l’IREM et de l’ENCCRE, autrement dit à l’interface entre des organismes de formation et d’un projet d’humanités numériques portant sur l’édition d’un objet historique patrimonial. Le projet lui-même, son contexte, son objet et ses enjeux de départ ayant déjà présenté dans un colloque (Bernard, Francisco do Carmo, Herrero, à paraître) et lors de la dernière rencontre HiDiM (Paris, oct 2024), il s’agit ici de théoriser un de ses aspects émergents, à savoir que la conception de ces supports est lié à une activité de recherche, soit parce qu’elle est le terrain, le lieu d’une recherche en histoire des sciences; soit parce qu’elle reflète et/ ou stimule des recherches d’ordre didactiques et pédagogiques. L’objet vidéographique peut ainsi être pensé comme un objet frontière dont le concept a déjà été convoqué pour analyser des dispositifs de recherche et formation (Bernard et Petitgirard, 2018). Fernando Bifano et Nicolás Igolnikov Comment intégrer l’histoire des mathématiques dans la formation des enseignants ? Le travail d'interprétation des sources historiques pour favoriser la compréhension des productions des étudiants. Quelle valeur l'histoire des mathématiques peut-elle avoir pour la formation des futurs enseignants ? Dans quelle mesure la connaissance de l'histoire peut-elle aider à dépasser les visions naïves et stéréotypées de la science ? Quelle peut être la contribution didactique à la formation en approchant les sources de l'histoire et en promouvant un exercice d'interprétation afin de comprendre comment la connaissance mathématique s'est construite à travers différentes cultures et moments historiques ? Telles sont quelques-unes des questions qui structurent cette présentation liée à l'axe 4 de ce congrès. Ils rendent compte de différents cas de travail avec des étudiants professeurs de mathématiques dans le contexte des cours d'histoire des mathématiques, une matière obligatoire dans le programme des professeurs de sciences en Argentine. Matthias Cléry et Addi Yannis Des outils numériques au service de l’exploration historique et de la valorisation du patrimoine mathématique dans le cadre de l’ANR PatriMaths Le projet ANR PatriMaths étudie, du point de vue historique, les processus de patrimonialisation dont les mathématiques ont fait l’objet, du XVIIIe au XXe siècle, via des supports imprimés rassemblant ce qu’il vaut la peine de conserver des savoirs mathématiques (encyclopédies, dictionnaires spécialisés ou généralistes, œuvres complètes de mathématiciens, collections de traités et de manuels) ou destinés à rassembler et répertorier une partie des savoirs déjà produits (bibliothèques, répertoires bibliographiques). Dans ce cadre, une réflexion sur les humanités numériques comme outils de la recherche en SHS a conduit au développement d’une base de connaissance portant sur des encyclopédies et des bibliothèques. En s’appuyant sur les technologies du web sémantique et des données liées, cette plateforme permettra de décrire sémantiquement un ou plusieurs corpus (par exemple des dictionnaires de mathématiques ou les manuels) et mettra ainsi en évidence la construction de patrimoines mathématiques et les dynamiques de longue durée dans lesquelles ils prennent sens. La présentation, s’inscrivant dans l’axe 1 de ces journées du RT HiDiM, présentera cette base de données et les usages heuristiques qui peuvent en être fait pour l’histoire des mathématiques. Karine Fouchet-Isambart Travail sur une taxonomie des erreurs permettant l’élaboration d’un feedback personnalisé sur une plateforme numérique d’exerciseurs Dans l'enseignement des mathématiques au collège et au lycée, les enseignants rencontrent des difficultés à identifier précisément les besoins individuels de chaque élève. Cette problématique est amplifiée par l’hétérogénéité croissante des classes, qui complique l’adaptation des pratiques pédagogiques. En effet, selon les enseignants, « plus l’hétérogénéité est importante au sein d’un groupe classe, plus leur travail est difficile et moins ils peuvent accompagner efficacement l’apprentissage de leurs élèves. » (Galand, 2009, p.6). L’émergence d'outils numériques, tels que les exerciseurs utilisant l'intelligence artificielle, ouvre cependant de nouvelles perspectives pour soutenir les pratiques pédagogiques. En proposant des parcours d’apprentissage personnalisés et en fournissant un feedback immédiat aux élèves, ces outils contribuent à une meilleure compréhension des concepts et favorisent une correction progressive des erreurs. Cependant, malgré ces avancées, il reste difficile de fournir à chaque élève un retour personnalisé tenant compte de ses erreurs. Il nous apparait alors essentiel d’enrichir ces outils numériques par une analyse précise et systématique des erreurs afin de construire une rétroaction précise à l’élève et en adéquation avec le type d’erreur produit par celui-ci relativement à un type de tâches et une technique. Ainsi, le simple fait que le logiciel identifie une réponse comme incorrecte par rapport à la solution attendue ne suffit pas à offrir un feedback personnalisé. Celui-ci doit inciter l’élève à s’interroger et à transformer l’erreur en un véritable outil d’apprentissage. Dans cette perspective, l’élaboration d’une taxonomie des erreurs nous semble indispensable. Une classification rigoureuse permettrait en effet d’identifier différents types d’erreurs et d’intégrer cette information dans les logiciels éducatifs afin de proposer des feedbacks différenciés et adaptés aux types d’erreurs repérés. Or, la littérature existante propose encore peu de classifications des erreurs en mathématiques. Cette présentation visera d’abord à introduire cet outil numérique, puis à exposer différentes classifications d’erreurs existantes (Astolfi, 1997 ; Charnay et Mante, 1990 ; Ford et al., 2018). Enfin, nous détaillerons la construction de notre propre taxonomie des erreurs, qui constitue une étape essentielle pour concevoir des feedbacks personnalisés et adaptés aux besoins de chaque élève. Nicolas Joannes Utilisation de la vision artificielle dans l'étude des illustrations des éditions du Traité de Géométrie de Sébastien Leclerc de 1690 à 1835 L’étude des illustrations mathématiques dans les imprimés se heurte parfois à un obstacle quantitatif. Que ce soient des gravures sur bois ou des planches de cuivre, il n’est pas rare qu’un ouvrage, notamment de géométrie, soit illustré de centaines de figures, par exemple 270 dans la traduction des Principes Mathématiques (1726) par Émilie du Châtelet, plus de 400 dans le Traité de Géométrie (1690) de Sébastien Leclerc, près de 800, en incluant les instruments, l’optique, l’astronomie, etc., dans l’Encyclopédie (1767) de Diderot et D’Alembert. Cette profusion rend difficile un travail de comparaison exhaustif des figures et limite les perspectives d’analyse des modalités d’emprunt ou de copie des illustrations dans le corpus des productions mathématiques. Dans le cadre de ma thèse consacrée à la circulation des illustrations mathématiques à l’époque moderne, l’utilisation d’un algorithme de détection de similarités dans de larges corpus d’images, en cours de développement dans le cadre du projet VHS, permet de faciliter ce travail d’identification des sources connues ou supposées, ou de reprises ultérieures. En nous appuyant sur le travail effectué sur cinq éditions du Traité de Leclerc, nous montrerons que l’identification et la correspondance identifiée de chacune des illustrations, en partie automatisées par des algorithmes de vision artificielle, permettent un travail exhaustif de comparaison des illustrations entre les ouvrages, ce qui permet de retracer plus finement leur filiation et améliore ainsi la compréhension de leurs modalités de production. Gaston Yerbanga et Fabrice Vandebrouck Intelligence artificielle dans l’activité d’étudiants en mathématiques en première année d’université Dans le cadre de notre thèse, nous avons proposé à des groupes d’étudiants dans un dispositif « mini projets » de comprendre comment solutionner de façon optimale la tâche lights out Lights Out en mobilisant leurs connaissances mathématiques mais aussi toute ressource numérique en ligne qui peut leur sembler pertinente. Nous avons analysé le potentiel de cette tâche pour révéler la capacité des étudiants à exploiter des outils d’IA. Nous avons effectué des observations et des recueils de traces de l’activité de plusieurs groupes d’étudiants que nous aurons commencés à analyser pour le colloque en mars. Partie Jeunes chercheuses et jeunes chercheurs Communications Sylvain Doussot
Professeur des universités (didactique de l'histoire), Institut national supérieur du professorat et de l'éducation - Site de Nantes Centre de recherche en éducation de Nantes (Cren)
Enjeux didactiques de l’usage de l’histoire pour enseigner les mathématiques : un regard en didactique de l’histoire La conférence abordera la question des relations entre l'histoire et la didactique d'une discipline, sous l'angle des enjeux épistémologiques pour penser l'enseignement-apprentissage. Elle le fera du point de vue de la didactique de l'histoire, et considérera en particulier le cas de l'enseignement-apprentissage des mathématiques. Quatre modalités du rapport au passé seront discutées à partir de l'épistémologie de l'histoire et de l'historiographie : l'usage de "petites histoires", l'usage de sources du passé, l'usage de textes d'historiens, et l'usage de textes d'épistémologie de la discipline.
Edgar Lejeune
Post-doctorant à la Chaire d’Excellence en Édition Numérique (CEREdI, Université de Rouen Normandie) Chercheur associé au laboratoire SPHERE (CNRS, Université Paris-Cité) Modélisations, corpus et analyses statistiques. Comment les pratiques des historiens se transforment-elles au contact des sources éditées sur supports numériques ?
En histoire, comme dans beaucoup d’autres disciplines, l’utilisation des ordinateurs a profondément affecté les façons par lesquelles les chercheurs accèdent aux documents qui fondent leurs recherches. Au cœur de ces transformations, on trouve notamment l’usage massif d’instruments d’érudition édités et publiés sur supports numériques, qui se donnent pour fonction de donner accès aux sources historiques et à leur contenu d’une façon renouvelée. On compte parmi eux des éditions numériques de textes, des bases de données, des collections d'archives numérisées, des inventaires en ligne, etc. Ils proposent de nouvelles fonctionnalités de recherche et/ou d’analyse : recherche en texte intégral, outils de traitement des données, interface de
programmation d’application (API), hyperliens, etc. La présente communication propose de montrer comment les pratiques des historiens se sont transformées au contact de ces instruments numériques d’érudition depuis les années 1960. Pour ce faire, je m’appuierai sur trois études de cas : l’enquête sur le catasto florentin de 1427 dirigée par David Herlihy et Christiane Klapisch-Zuber, l’étude d’un corpus de textes politiques anglais menée par Jean-Phillipe Genet et le travail d’Alain Guerreau sur l’implantation des ordres mendiants. Je propose de me concentrer sur les relations entre trois opérations fondamentales : la modélisation des sources, leurs mises en corpus et les analyses statistiques mises en oeuvre. Ce faisant, il sera possible de montrer précisément comment la mise en place de méthodes computationnelles contribuent à façonner des pratiques des sources nouvelles, et de comprendre leurs effets sur l’historiographie de certains domaines. Cette approche permettra de montrer que les instruments d’éruditions constitués au cours de ces travaux ne sont pas neutres. D’une part, ils véhiculent avec eux les questions de recherche qui les ont vu naître. Ils sont produits en lien avec des postulats théoriques et des approches méthodologiques locales, souvent très élaborés. D’autre part, ces instruments numériques d’érudition endossent des fonctions épistémologiques limitées, définies en accord avec les objectifs que leurs producteurs leur ont attribué dans un contexte scientifique et matériel donné.
|